DESSIN
NOUVELLES
A. DÜRER
CINEMA
MA PRODUCTION
Pastels
Découpages
Dessins
Aquarelles
Photos
Gravures
BD
3 crayons
Compositions
VRAC
CONTACT
Un lavis de
Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)
L'oraison de Saint-Julien
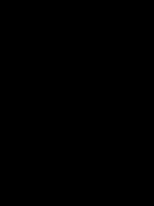

Ce lavis de bistre réalisé vers 1775 par Jean-Honoré Fragonard fait partie d'un ensemble d'illustrations des
Contes de la Fontaine. Dans L'oraison de Saint-Julien, un voyageur nommé Renaud d'Ast, confesse en chemin à trois inconnus d'apparence honnête, dire occasionnellement pour se protéger, une oraison à Saint-Julien. Les hommes le dépouillent, le détroussent et lui conseillent finalement de dire son oraison. L'homme trouve refuge chez une femme et sa servante. Cette femme s'avère être "une veuve galante pleine d'appas, et de bonne grâce" tandis que Renaud est "grand, bien fait, beau personnage"...Fragonard a usé de la plume et du lavis pour brosser cette scène. Il a peut-être utilisé la plume avec les mélanges faits pour le lavis ; du moins les lignes à la plume sont tracées avec différents mélanges encre-eau (voir par exemple les traits clairs sur le bras et la cuisse du personnage féminin). Les traits de plume, courbes, incisifs et nombreux dans les personnages, deviennent rares et longilignes dans le haut du dessin où ils se distinguent moins sur l'encre sombre mais permettent cependant une bonne délimitation des éléments du décor. L'encre posée en larges surfaces au premier plan, au sol, sur le décor des murs et du plafond est dispensée au contraire par petites touches sur les vêtements des personnages pour en mimer les plis.

Quoique le rendu de la lumière souffre peut-être de quelques négligences de détail (couleur sur le dos de la servante), on est frappé par l'impression de lumière vive émanant de l'âtre... Or c'est précisément ce que ne permet pas naturellement le lavis, contrairement aux techniques autorisant l'ajout d'une matière claire sur un support de valeur moyenne. Au lavis, pour donner l'impression de lumière vive dans une partie de l'espace, il faut poser des valeurs foncées partout ailleurs... exercice périlleux et remarquablement réussi ici.
Fragonard a donc réalisé, pour illustrer L'oraison de Saint-Julien, un dessin très enlevé dans le style rapide et efficace retenu pour l'ensemble des illustrations. Quoiqu'il ne se soit pas contraint dans ce dessin à rendu minutieux et réaliste, dont usé quelque fois - voir ci dessous -, il a conféré à cette scène une remarquable impression de lumière (avec une technique peu favorable) de vie et d'espace.
Pour comparaison, La visitation de la vierge, crayon et lavis gris (non daté) et Illustration pour le Conte Le villageois cherche son veau (vers 1775).


Le contraste entre ces lavis renvoie à celui des oeuvres peintes, dans lesquelles Fragonard a animé scènes et visage avec un égal talent, qu'il use de larges coups de brosse ou de touches fines et soignées.




Trois "figures de fantaisie" ("peintes en une heure de temps"...) - portrait de l'abbé de Saint-Non, L'étude (vers 1769), portait de Mademoiselle Guimard (1767)- et Jeune fille délivrant un oiseau de sa cage.


Corésus et Callirhoé (vers 1762), Renaud dans les jardins d'Armide (non daté).
Pierre-Paul Prud'hon et introduction
Léonard de Vinci |
Raphaël |
Albrecht Dürer |
J.-H. Fragonard |
E. Delacroix |
Victor Hugo |
J.-F. Millet |
V. van Gogh |
Balthus |
à suivre |